Napoléon III - Sa politique pour l'Algérie
NAPOLÉON III
Sa politique pour l'Algérie - 1852 / 1870
Sa politique pour l'Algérie - 1852 / 1870
Les historiens reconnaissent la formidable impulsion qu'a donné le Second Empire à l'activité économique et au développement des technologies et des transports dans notre pays, à la fin du XIXème siècle. Le baron Haussmann et le duc de Morny ne sont évidemment pas étrangers à ces avancées.
Pourtant, un aspect de cette activité est assez méconnue et c'est précisément celle qui nous intéresse aujourd'hui : la politique de Napoléon III pour l'Algérie. Et c'est surprenant, voire visionnaire même si on prend en compte l'influence Saint-Simonienne de l'époque.
Napoléon III n'a pas été suivi et la défaite de Sedan a scellé le sort du Second Empire en même temps que celui de l'Algérie.
A vous de jugez en toute sérénité car 142 années sont passées par là !
FR - 2012
C'est en Algérie que va se manifester avec le plus d'éclat le volontarisme napoléonien. L'Algérie française est une colonie qui n'est pas acquise à l'empereur. Les électeurs y avaient désapprouvé le coup d'État lors du plébiscite de décembre 1851. La colonie est d'abord négligée dans les premières années du règne et laissée sous le contrôle de l'armée.
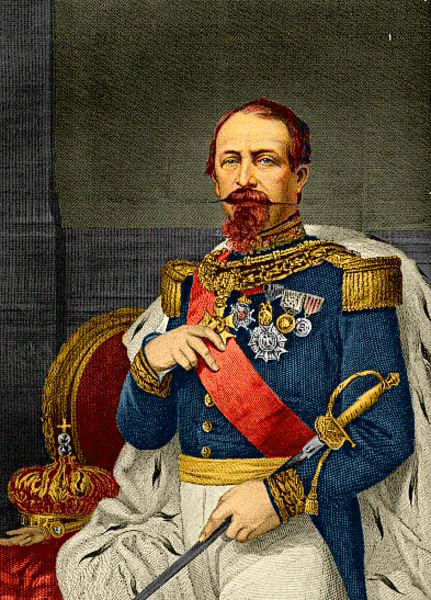
Napoléon III
Il envisage à l'époque la création d'une entité arabe centrée sur Damas et dirigée par l'émir Abd el-Kader, ancien chef de la rébellion algérienne qu'il avait fait libéré en 1852 et qui vivait depuis en Syrie. Ainsi constituée, cette nation arabe serait placée sous la protection de l'Empereur des Français. En 1862, dans cette perspective, il expose sa vision, teintée de paternalisme, du développement de l'Algérie basé sur « l'égalité parfaite entre indigènes et européens ». Pour lui, l'Algérie n'est pas une colonie mais un royaume arabe, « les indigènes comme les colons ont aussi droit à ma protection. Je suis l'Empereur des Français et des Arabes ». En Algérie, la déclaration est non seulement mal reçue par les autorités militaires dirigées successivement par le maréchal Pélissier puis par le maréchal de Mac-Mahon, mais aussi par les colons soutenus en métropole par Jules Favre et Ernest Picard.
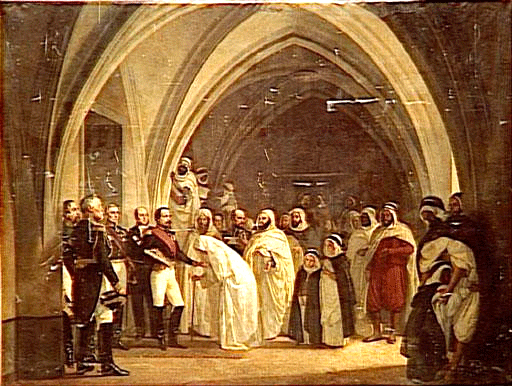
Napoléon III rend la liberté à l'émir Abd-el-Kader.
Tableau par Ange Tissier (1861)
Après un premier sénatus-consulte du 22 avril 1863 qui avait réformé le régime de propriété foncière pour délimiter les terres des tribus et les protéger des confiscations abusives, un autre en date du 14 juillet 1865 accorde la nationalité française aux Algériens musulmans (et aussi juifs) accompagnés de droits civils et politiques à condition qu'ils aient renoncé à leur statut personnel fixé par la loi religieuse (ils doivent concrètement renoncer à la polygamie, au divorce alors interdit en France et aux prescriptions du droit successoral coranique).
Mais ces diverses initiatives, comme celle de donner une constitution à l'Algérie, ne résistent pas à l'opposition des colons, majoritairement hostiles à l'Empire, puis à la famine* qui affecte la colonie à la fin des années 1860. L'idée d'instaurer un royaume en Algérie uni à la France par des liens personnels et dirigé par les autochtones est finalement abandonnée en 1869.
* 1867-68 : Disette, famine, choléra et guerres coûtent la vie à 300 000 personnes.